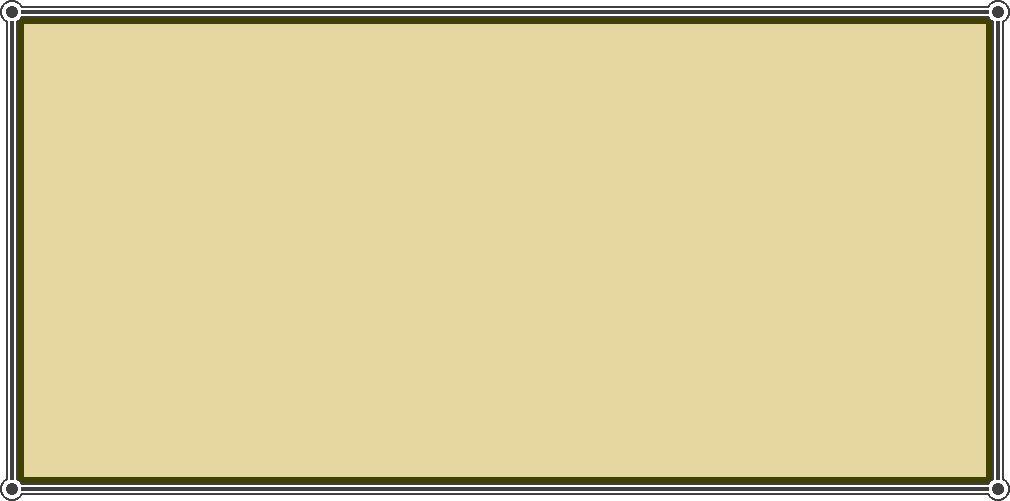
Conférence sur GIONO
par François d’Izarny-Vargas
de l’Académie d’Aix en Provence
par François d’Izarny-
de l’Académie d’Aix en Provence
Il y a une certaine outrecuidance à présenter une communication sur un auteur aussi admiré, aussi reconnu, aussi étudié que Jean Giono. Et ceci d’autant plus que je n’ai aucune révélation à faire sur un détail de l’un de ses romans, aucune thèse à proposer sur le sens de son œuvre. Je suis persuadé qu’il y a parmi vous
des lecteurs de Giono aussi et plus attentifs que moi. Je fais donc appel à votre indulgence, et je n’invoque pour me justifier qu’une seule circonstance atténuante : de mémoire d’académicien, Jean Giono n’a fait l’objet d’aucune communication devant votre assemblée ; il y a là une lacune à combler.
Le titre donné à cette communication n’a certainement trompé personne parmi vous : il n’y a pas deux écrivains du nom de Giono, comme il y a Alexandre Dumas père et Alexandre Dumas fils, ou les frères Edmond et Jules de Goncourt. Mais lorsque l’on effectue un survol de l’œuvre romanesque de Giono, on est toujours frappé par les différences entre les deux versants de cette œuvre. Comme diraient les peintres, il y a deux « manières » : d’une part, ce que j’appellerai le premier Giono qui va de 1929, date de la première publication d’un de ses romans, à 1939, et d’autre part le second Giono, de 1947 à sa mort en 1970.
Cette communication va donc être d’abord consacrée à une présentation de quelques uns des romans de chacune de ces périodes, et surtout de leurs caractéristiques : le style, bien sûr, mais aussi les personnages, les lieux, les intrigues. Je vous proposerai ensuite une tentative d’explication du passage du premier au second Giono.
Le premier Giono.
En 1929, le premier roman publié d’un inconnu, alors âgé de trente quatre ans, obtient un grand succès : Colline, dont l’action toute entière est située aux Bastides Blanches, hameau perdu sur le flan sud de la montagne de Lure.
Dès les premières lignes, en posant le décor de son roman, Giono dévoile le style qui va être le sien au cours des années à venir : « Quatre maisons fleuries d’orchis jusque sous les tuiles émergent de blés drus et hauts. C’est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras ». La terre est ici décrite comme un corps humain ; un peu plus loin : « La nuit emplit déjà la vallée ; elle effleure la hanche de la colline. Les olivaies chantent sous l’ombre ». Nous retrouverons cette métaphore à plusieurs reprises dans les premiers romans de Jean Giono.
Dans ces quatre maisons habitent treize personnes, hommes, femmes, enfants, tous paysans, que l’auteur nous décrit sommairement. Après cette exposition rapide, on entre vite au cœur du sujet : Janet, le patriarche du village est tombé malade. Et surtout, il « déparle », comme dit son gendre Gondran, c’est-
La maladie et le délire du vieux Janet sont une introduction à la série de malheurs qui s’abat sur le village. Tout d’abord, la fontaine cesse de couler : plus d’eau, c’est la vie des habitants qui est menacée. Heureusement, l’un d’entre eux voit Gagou, l’idiot du village, revenir un matin le pantalon et les cheveux trempés d’eau. Comme on ne peut rien tirer de lui, la nuit suivante deux hommes le suivent. Et c’est l’occasion d’une belle description : « La nuit plus fraîche est comme une promesse sur leurs joues ; devant eux se dresse le grand corps de Lure, la mère des eaux, la montagne qui garde l’eau dans les ténèbres de sa chair poreuse. Au fond de l’air tremble la flûte d’une source. La lumière de la lune coule des hauteurs du ciel, jaillit en poussière blanche et l’ombre de Gagou nage sous elle comme un poisson. »
Toujours à la suite de Gagou, les hommes parviennent à un village en ruine. Et sur la place de ce village, la fontaine coule. Les Bastides Blanches sont sauvées.
Mais dans les jours, qui suivent, d’autres malheurs arrivent : une petite fille de cinq ans tombe malade. Et un incendie se déclare dans la colline. « La bête souple du feu a bondi d’entre les bruyères (…) Elle était à ce moment-
L’incendie se rapproche dangereusement des Bastides Blanches où les femmes et les enfants se sont retranchés. Un contre-
Mais cette fois-
Evidemment, il faut se poser la question : quel est le sens de la fin de ce livre ? Quel message l’auteur a-
Giono lui-
Les personnages de Colline sont donc victimes de ce dieu et leur combat pour la vie est un combat contre les forces mystérieuses de la nature : « Cette terre qui s’étend, grasse, lourde, avec sa charge d’arbres et d’eau, ses fleuves, ses ruisseaux, ses forêts, ses monts et ses collines, (…) si c’était une créature vivante, un corps ? Avec de la force et de la méchanceté ? », se demande l’un des villageois.
Et ailleurs : « Il m’est venu à l’idée que derrière l’air et dans la terre, une volonté allait à la rencontre de la nôtre et que ces deux volontés étaient butées de front comme deux chèvres qui s’en veulent ».
En ce sens, la vision que Giono a du monde, d’après cette première œuvre, est tragique : la nature n’est pas bonne, elle est hostile à l’homme. On découvre ici un Giono très différent de l’image que l’on a le plus souvent de lui.
L’intrigue du roman suivant, Un de Baumugnes, n’a rien à voir avec celle de Colline. On nage ici en plein mélodrame : Angèle, la fille d’un paysan des bords de la Durance, a été séduite et enlevée par un voyou qui l’a mise sur le trottoir à Marseille. Revenue dans la ferme de ses parents avec un bébé, son père la séquestre pour cacher le déshonneur de la famille. Albin, un ouvrier agricole secrètement amoureux d’elle, la retrouve, se fait connaître d’elle grâce à la musique qu’il joue pour elle et l’enlève à son tour, mais cette fois pour la bonne cause.
Deux raisons font qu’Un de Baumugnes n’est pas un roman de gare :
- Tout d’abord, l’histoire est racontée par un vieil ouvrier agricole nommé Amédée, qui s’est attaché à Albin et qui l’aide dans sa recherche d’Angèle. Amédée parle donc à la première personne et ponctue le récit de ses commentaires, parfois savoureux : on découvre alors un humour que l’on ne trouvait pas dans Colline.
Et Amédée donne aussi la parole à Albin, ce qui crée un récit dans le récit : Giono fait preuve ici d’une grande virtuosité technique qui lui servira dans d’autres romans.
- Le style, ensuite : c’est Amédée, simple ouvrier agricole qui est sensé s’exprimer, avec son langage et ses expressions. Mais évidemment, jamais les paysans de Haute Provence n’ont parlé comme parlent les paysans de Jean Giono ! Celui-ci crée de toutes pièces un langage particulier, avec ses images et ses néologismes, qui a des allures de « provençalisme rustique » (l’expression est de son biographe Pierre Citron) et qui est la poésie même.
On peut citer quelques passages : celui-
Le troisième roman de la trilogie, Regain, se situe dans un village encore plus dépeuplé que celui de Colline : Aubignane ne compte plus que trois habitants, dont l’un s’en va dès le début du roman. Ne restent que la Zia Mamèche, vieille Piémontaise, et Panturle, un géant, une force de la nature, qui vit de braconnage. La Zia Mamèche disparaît du village et du roman après avoir dit à Panturle : « Il te faut une femme ».
La veille de son départ, la Zia Mamèche a montré le sud à Panturle en lui disant : « ‘ça vient, ça vient !’ Elle n’est pas un peu folle, se demande Panturle. Quand même, il se retourne vers le sud, lui aussi ; ça a changé depuis la tombée du jour : une force souple et parfumée court dans la nuit. On dirait une jeune bête bien reposée. C’est tiède comme la vie sous le poil des bêtes, ça sent amer. Il renifle. Un peu comme l’aubépine ; ça vient du sud par bonds et on entend toute la terre qui en parle. Le vent du printemps ! »
Grâce à la Zia Mamèche, Panturle rencontre une femme et l’enlève à l’homme qui la traitait en esclave ; sous l’influence de cette femme, il renonce au braconnage, il confectionne une charrue, laboure un champ abandonné, emprunte des semences, plante du blé… Sa récolte se révèle d’une qualité exceptionnelle. Et Arsule, la jeune femme, attend un enfant. Et le village d’Aubignane renaît : une famille entière vient s’y installer pour y cultiver la terre. C ette conclusion montre l’autre visage du dieu Pan, sa puissance mise au service des moissons et des troupeaux.
Jean Giono avait une très grande capacité de travail, et ses trois premiers romans ont été publiés en moins de deux ans, en 1928 et 1929. A l’issue de ces deux années, il était passé d’un statut d’inconnu à celui de très grand écrivain. Au cours des années suivantes, il a encore beaucoup publié ; on peut tout de même s’appuyer essentiellement sur ces trois premiers romans pour énoncer les caractéristiques principales de la première manière :
- Les personnages sont des paysans. On les voit en train d’effectuer les travaux agricoles : labours, récoltes… Au contraire, la ville est un lieu de perdition, comme Giono l’écrit dans Colline : « ce qui vient de la ville est mauvais ». Il développera ce point de vue dans beaucoup d’articles et d’essais de cette période.
- Ces paysans luttent ensemble contre la nature et les éléments (voir aussi Batailles dans la montagne, où un village entier est détruit par la rupture d’un glacier, et dont les survivants s’unissent pour leur sauvetage commun).
- L’action est située à une période indécise, au début du XXème siècle, dans des régions qui sont très loin du progrès technique : pas d’automobile, pas d’électricité.
- Giono met en scène ces personnages sans raconter, comme le fait par exemple Balzac, l’histoire de chacun d’entre eux. Pas d’explication psychologique non plus : Jean Giono s’inscrit dans une littérature comportementaliste où ce sont leurs actions qui donnent les clés des personnages.
- Le style est lyrique, avec une volonté de poétiser le langage des paysans.
- L’humour est presque totalement absent.
Le second Giono.
Si vous voulez bien, nous allons sauter environ huit années, de 1939 à 1947, date de publication du premier roman de Giono après la guerre : Un Roi sans Divertissement. Nous reviendrons sur ces années tout à l’heure, pour y chercher quelques clés.
L’action d’Un Roi sans Divertissement est située en montagne, dans un village du Trièves qui n’est pas nommé. Nous sommes pendant l’hiver 1843 et le village est isolé par la neige très abondante. Trois habitants disparaissent les uns après les autres et une tentative avortée montre qu’il s’agit bien de meurtres. Un capitaine de gendarmerie nommé Langlois, vient s’installer au village avec ses hommes ; il devient le personnage principal du roman.
A l’occasion du meurtre suivant, le hasard permet à l’un des villageois de découvrir les cadavres en haut d’un hêtre magnifique, de surprendre l’assassin, de le suivre dans la neige jusqu’à un autre village, de repérer son domicile et même d’apprendre son nom, indiqué par une initiale, M. V. Prévenu, Langlois monte à la hâte une expédition, arrive au village voisin, entre dans la maison du meurtrier, échange quelques mots avec lui, l’emmène dehors et le tue de deux coups de pistolet. Il ne lui reste plus qu’à expliquer cet « accident » par un mauvais entretien de ses armes et à démissionner de la gendarmerie.
Or, l’hiver suivant, Langlois revient au village où son prestige est immense, non plus comme gendarme, mais comme lieutenant de louveterie. Il organise une grande battue pour chasser un loup particulièrement dangereux : tout le village suit les rabatteurs qui obligent le loup à fuir au fond d’un vallon étroit fermé par une falaise. Arrivé au pied de la falaise, le loup fait face à ses poursuivants ; Langlois s’approche alors et le tue de deux coups de pistolet, comme il avait tué l’assassin.
A ce point du récit, le roman prend son temps. Un an au moins s’écoule, pendant lequel Langlois devient de plus en plus énigmatique, lointain, fuyant : ses amis essayent de chasser son ennui, ils organisent une fête pour lui, ils lui trouvent même une femme, qu’il épouse. Manifestement, rien n’y fait. Et un jour d’automne, Langlois demande à une villageoise de décapiter une oie devant lui. Il prend l’oie par les pattes et regarde longuement le sang couler sur la neige fraîche. Le même soir, il sort comme d’habitude pour fumer son cigare. « Seulement, ce soir-là, il ne fumait pas un cigare : il fumait une cartouche de dynamite. (…) Et il y eut, au fond du jardin, l’énorme éclaboussement d’or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C’était la tête de Langlois qui prenait, enfin, les dimensions de l’univers ».
La question est évidemment la suivante : quels sont les mobiles, d’abord de M. V. l’assassin, puis de Langlois ? Giono ne met pas en scène un détective qui, dans le dernier chapitre dévoilerait les clefs de l’énigme, en fumant sa pipe devant ses auditeurs médusés. Il se contente de donner quelques pistes, dont la pensée de Pascal qui donne son titre au roman : un roi sans divertissement est un homme plein de misères. M. V., dans son village sous la neige, s’ennuie ; il est à la recherche de divertissement. A ce sujet, il y a un passage du roman très révélateur : Langlois, installé dans le village pour le protéger du criminel, va, peu avant Noël, rencontrer le curé. La conversation s’engage à propos de la messe de minuit, que prépare le curé et qui inquiète Langlois.
« - Très bien, très bien, dit Langlois, vous dites donc qu’il y aura des ostensoirs et des candélabres et des vestes, enfin des uniformes, semblables à ceux-là dans toutes les églises du canton ?
« - De plus beaux, de bien plus beaux, dit M. le curé (…).
« - Eh bien ! dit Langlois, disons cette messe-là, j’ai l’impression qu’on ne risquera peut-être pas grand-chose. »
Effectivement, pas de meurtre cette nuit-là : l’assassin a trouvé dans la splendeur des cérémonies religieuses un divertissement suffisant. Mais quelques mois plus tard, Langlois est aux prises avec le même démon que M. V., l’ennui, et rien, pas même le mariage et les plaisirs qu’il procure, ne vient à bout de cet ennui. Langlois constate à quel point il est semblable à M. V. : seul le sang offre un divertissement capable de le tirer de ses misères. Plutôt que commettre un autre meurtre, il préfère se suicider.
Les lecteurs d’Un Roi sans Divertissement ont été surpris par les changements intervenus dans la manière de Giono. Premier changement important : l’action est racontée par des narrateurs différents. Dans les premières pages du livre, c’est le romancier qui, aujourd’hui c’est-à-dire en 1947, enquête sur des faits anciens. Mais ensuite il donne la parole à des témoins de l’époque, à des acteurs même de la tragédie : c’est un procédé qui nécessite une grande virtuosité de la part du romancier et une grande attention de la part du lecteur, mais qui donne beaucoup de vie au roman.
Autre aspect du Giono nouveau que nous voyons naître ici : son style. Voici l’arrivée de l’automne en montagne : « Je suppose que vous savez où l’automne commence ? Il commence exactement à deux cent trente cinq pas de l’arbre marqué M 312, j’ai compté les pas. (…) Ce matin, quand vous ouvrez l’œil, vous voyez mon frêne qui s’est planté une aigrette de perroquet jaune d’or sur le crâne. Le temps de vous occuper du café (…), il ne s’agit déjà plus d’aigrette, mais de tout un casque fait des plumes les plus rares : des roses, des grises, des rouilles. Puis ce sont des bufflèteries, des fourragères, des épaulettes, des devantiers, des cuirasses qu’il se pend et qu’il se plaque partout ; et tout cela est fait de ce que le monde a de plus rutilant et de plus vermeil. » J’arrête ici la citation, il y en a des pages entières : sa description utilise un intermédiaire, le vocabulaire militaire, pour nous faire voir ce paysage grandiose. Il y a là un brio, une mise à distance de son sujet, un humour même qui n’ont rien à voir avec le Giono « première manière ».
Entendons-nous bien : la nature est toujours présente, comme dans les premiers romans, mais elle a cessé d’être une force obscure qu’il faut combattre et dompter. Elle n’est plus qu’un décor au sein duquel se déroule l’action ; la neige en particulier occupe beaucoup de place, mais c’est parce qu’on marche dedans pendant presque tout le roman, et aussi parce que le sang répandu sur son tapis blanc fait un bien bel effet : un effet qui hypnotise Langlois et lui fait prendre conscience de son désir secret, de sa tentation de la violence.
Giono a rédigé Un Roi sans divertissement pour faire une pause dans l’écriture d’une série romanesque qui l’a occupé pendant plus de dix ans : le cycle du Hussard. Le premier de ces romans a pour titre Angelo, du nom du héros. Nous sommes en 1840. Angelo est Italien ; fils naturel d’une duchesse, il est colonel de hussards, il est jeune, beau, généreux et courageux ; idéaliste, il rêve de liberté pour son pays mais craint par-dessus tout de paraître ridicule. Cela ne vous rappelle rien ? Evidemment Angelo doit beaucoup aux héros de Stendhal, Fabrice del Dongo surtout, mais aussi Lucien Leuwen ; nous y reviendrons.
Dès la première page du roman, on apprend la mort en duel à Turin, d’un espion au service de l’Autriche ; le coup de sabre qui l’a tué « exige dix ans de pratique et trois cents ans de désinvolture héréditaire ». Ce coup est une véritable signature et désigne sans erreur possible son auteur, qui n’est autre qu’Angelo ; le jeune homme échappe à la police sarde, passe en France au mont Genèvre, prend à Gap la diligence pour Aix et s’installe quelques mois dans cette ville, ce qui justifie, si vous le voulez bien, un peu de curiosité en ce qui concerne les lieux fréquentés par notre héros et cités par Giono.
D’abord le plateau du Cengle : « Le cheval était nourri dans les écuries de l’archevêché. Angelo le jugea vite : trop d’avoine, mais un cœur droit. Il l’utilisa selon son jugement et fit une entrée très remarquée dans les bosquets du Cengle où quelques guinguettes pour parties fines entouraient la salle d’armes ».
Toujours au pied de Sainte Victoire, voici Saint Antonin. Une chanteuse avec laquelle Angelo a une liaison lui dit : « Nous partirons vers les midi pour Saint Antonin où il y a une petite auberge que tu aimeras et des paysages qui seront chers à ton cœur (…) Espérons, pense Angelo, que les paysages sont aussi beaux qu’elle le prétend. Ils étaient plus beaux, poursuit Giono : ils ressemblaient à des paysages de Toscane ».
Evidemment, il n’y a jamais eu de guinguettes sur le plateau du Cengle et les paysages autour de Saint Antonin sont très beaux mais n’ont rien à voir avec ceux de la Toscane. Comme dans ses premiers romans, Giono donne aux endroits visités par ses personnages des noms de lieux réels, mais sans aucun rapport avec leur emplacement géographique.
L’intrigue principale du roman consiste dans la rencontre paradoxale du carbonaro piémontais avec un groupe d’aristocrates ultras. N’oublions pas que l’action se déroule sous la monarchie de juillet : certains légitimistes ne craignent pas d’attaquer des diligences pour se constituer un trésor de guerre, et le marquis de Théus cherche à utiliser le trop naïf Angelo pour assurer des liaisons avec d’autres comploteurs. Il y a aussi un vicaire général machiavélique tiré tout droit de Stendhal et il y a surtout la belle marquise de Théus, Pauline, dont Angelo tombe amoureux avant même de faire sa connaissance, rien qu’en respirant son parfum.
Signalons que Pauline et d’Angelo vont avoir une seconde « première rencontre » à Manosque, en plein choléra, dans le Hussard sur le toit. Pour éviter ce doublon, Giono a choisi de ne publier Angelo que treize ans plus tard.
Nous arrivons donc au Hussard sur le toit. Au premier chapitre, Angelo monte en cavalier solitaire le flan sud de la montagne de Lure ; la chaleur est étouffante. « C’était une lande où la lumière et la chaleur pesaient avec plus de poids. On pouvait même voir tout le ciel de craie d’une blancheur totale. L’horizon était un serpentement lointain de collines légèrement bleutées ». Angelo ne le sait pas, mais cette chaleur lourde favorise la diffusion du microbe qui va ravager la Provence.
Après une halte à Banon, Angelo atteint la crête qui va de Lure au Ventoux, il descend dans la vallée du Jabron (ici, la géographie est parfaitement respectée) et arrive au hameau des Omergues, où le choléra n’a laissé aucun survivant. Je vous épargnerai les descriptions des cadavres souillés par les vomissures et la diarrhée, ou dévorés par les animaux. Ces descriptions, que l’on retrouve tout le long du roman, ont été reprochées à Giono ; il faut probablement y voir un rappel de l’omniprésence du mal, qui prend ici une dimension métaphysique.
Si vous voulez bien, nous allons sauter environ huit années, de 1939 à 1947, date de publication du premier roman de Giono après la guerre : Un Roi sans Divertissement. Nous reviendrons sur ces années tout à l’heure, pour y chercher quelques clés.
L’action d’Un Roi sans Divertissement est située en montagne, dans un village du Trièves qui n’est pas nommé. Nous sommes pendant l’hiver 1843 et le village est isolé par la neige très abondante. Trois habitants disparaissent les uns après les autres et une tentative avortée montre qu’il s’agit bien de meurtres. Un capitaine de gendarmerie nommé Langlois, vient s’installer au village avec ses hommes ; il devient le personnage principal du roman.
A l’occasion du meurtre suivant, le hasard permet à l’un des villageois de découvrir les cadavres en haut d’un hêtre magnifique, de surprendre l’assassin, de le suivre dans la neige jusqu’à un autre village, de repérer son domicile et même d’apprendre son nom, indiqué par une initiale, M. V. Prévenu, Langlois monte à la hâte une expédition, arrive au village voisin, entre dans la maison du meurtrier, échange quelques mots avec lui, l’emmène dehors et le tue de deux coups de pistolet. Il ne lui reste plus qu’à expliquer cet « accident » par un mauvais entretien de ses armes et à démissionner de la gendarmerie.
Or, l’hiver suivant, Langlois revient au village où son prestige est immense, non plus comme gendarme, mais comme lieutenant de louveterie. Il organise une grande battue pour chasser un loup particulièrement dangereux : tout le village suit les rabatteurs qui obligent le loup à fuir au fond d’un vallon étroit fermé par une falaise. Arrivé au pied de la falaise, le loup fait face à ses poursuivants ; Langlois s’approche alors et le tue de deux coups de pistolet, comme il avait tué l’assassin.
A ce point du récit, le roman prend son temps. Un an au moins s’écoule, pendant lequel Langlois devient de plus en plus énigmatique, lointain, fuyant : ses amis essayent de chasser son ennui, ils organisent une fête pour lui, ils lui trouvent même une femme, qu’il épouse. Manifestement, rien n’y fait. Et un jour d’automne, Langlois demande à une villageoise de décapiter une oie devant lui. Il prend l’oie par les pattes et regarde longuement le sang couler sur la neige fraîche. Le même soir, il sort comme d’habitude pour fumer son cigare. « Seulement, ce soir-
La question est évidemment la suivante : quels sont les mobiles, d’abord de M. V. l’assassin, puis de Langlois ? Giono ne met pas en scène un détective qui, dans le dernier chapitre dévoilerait les clefs de l’énigme, en fumant sa pipe devant ses auditeurs médusés. Il se contente de donner quelques pistes, dont la pensée de Pascal qui donne son titre au roman : un roi sans divertissement est un homme plein de misères. M. V., dans son village sous la neige, s’ennuie ; il est à la recherche de divertissement. A ce sujet, il y a un passage du roman très révélateur : Langlois, installé dans le village pour le protéger du criminel, va, peu avant Noël, rencontrer le curé. La conversation s’engage à propos de la messe de minuit, que prépare le curé et qui inquiète Langlois.
« -
Effectivement, pas de meurtre cette nuit-
Les lecteurs d’Un Roi sans Divertissement ont été surpris par les changements intervenus dans la manière de Giono. Premier changement important : l’action est racontée par des narrateurs différents. Dans les premières pages du livre, c’est le romancier qui, aujourd’hui c’est-
Autre aspect du Giono nouveau que nous voyons naître ici : son style. Voici l’arrivée de l’automne en montagne : « Je suppose que vous savez où l’automne commence ? Il commence exactement à deux cent trente cinq pas de l’arbre marqué M 312, j’ai compté les pas. (…) Ce matin, quand vous ouvrez l’œil, vous voyez mon frêne qui s’est planté une aigrette de perroquet jaune d’or sur le crâne. Le temps de vous occuper du café (…), il ne s’agit déjà plus d’aigrette, mais de tout un casque fait des plumes les plus rares : des roses, des grises, des rouilles. Puis ce sont des bufflèteries, des fourragères, des épaulettes, des devantiers, des cuirasses qu’il se pend et qu’il se plaque partout ; et tout cela est fait de ce que le monde a de plus rutilant et de plus vermeil. » J’arrête ici la citation, il y en a des pages entières : sa description utilise un intermédiaire, le vocabulaire militaire, pour nous faire voir ce paysage grandiose. Il y a là un brio, une mise à distance de son sujet, un humour même qui n’ont rien à voir avec le Giono « première manière ».
Entendons-
Giono a rédigé Un Roi sans divertissement pour faire une pause dans l’écriture d’une série romanesque qui l’a occupé pendant plus de dix ans : le cycle du Hussard. Le premier de ces romans a pour titre Angelo, du nom du héros. Nous sommes en 1840. Angelo est Italien ; fils naturel d’une duchesse, il est colonel de hussards, il est jeune, beau, généreux et courageux ; idéaliste, il rêve de liberté pour son pays mais craint par-
Dès la première page du roman, on apprend la mort en duel à Turin, d’un espion au service de l’Autriche ; le coup de sabre qui l’a tué « exige dix ans de pratique et trois cents ans de désinvolture héréditaire ». Ce coup est une véritable signature et désigne sans erreur possible son auteur, qui n’est autre qu’Angelo ; le jeune homme échappe à la police sarde, passe en France au mont Genèvre, prend à Gap la diligence pour Aix et s’installe quelques mois dans cette ville, ce qui justifie, si vous le voulez bien, un peu de curiosité en ce qui concerne les lieux fréquentés par notre héros et cités par Giono.
D’abord le plateau du Cengle : « Le cheval était nourri dans les écuries de l’archevêché. Angelo le jugea vite : trop d’avoine, mais un cœur droit. Il l’utilisa selon son jugement et fit une entrée très remarquée dans les bosquets du Cengle où quelques guinguettes pour parties fines entouraient la salle d’armes ».
Toujours au pied de Sainte Victoire, voici Saint Antonin. Une chanteuse avec laquelle Angelo a une liaison lui dit : « Nous partirons vers les midi pour Saint Antonin où il y a une petite auberge que tu aimeras et des paysages qui seront chers à ton cœur (…) Espérons, pense Angelo, que les paysages sont aussi beaux qu’elle le prétend. Ils étaient plus beaux, poursuit Giono : ils ressemblaient à des paysages de Toscane ».
Evidemment, il n’y a jamais eu de guinguettes sur le plateau du Cengle et les paysages autour de Saint Antonin sont très beaux mais n’ont rien à voir avec ceux de la Toscane. Comme dans ses premiers romans, Giono donne aux endroits visités par ses personnages des noms de lieux réels, mais sans aucun rapport avec leur emplacement géographique.
L’intrigue principale du roman consiste dans la rencontre paradoxale du carbonaro piémontais avec un groupe d’aristocrates ultras. N’oublions pas que l’action se déroule sous la monarchie de juillet : certains légitimistes ne craignent pas d’attaquer des diligences pour se constituer un trésor de guerre, et le marquis de Théus cherche à utiliser le trop naïf Angelo pour assurer des liaisons avec d’autres comploteurs. Il y a aussi un vicaire général machiavélique tiré tout droit de Stendhal et il y a surtout la belle marquise de Théus, Pauline, dont Angelo tombe amoureux avant même de faire sa connaissance, rien qu’en respirant son parfum.
Signalons que Pauline et d’Angelo vont avoir une seconde « première rencontre » à Manosque, en plein choléra, dans le Hussard sur le toit. Pour éviter ce doublon, Giono a choisi de ne publier Angelo que treize ans plus tard.
Nous arrivons donc au Hussard sur le toit. Au premier chapitre, Angelo monte en cavalier solitaire le flan sud de la montagne de Lure ; la chaleur est étouffante. « C’était une lande où la lumière et la chaleur pesaient avec plus de poids. On pouvait même voir tout le ciel de craie d’une blancheur totale. L’horizon était un serpentement lointain de collines légèrement bleutées ». Angelo ne le sait pas, mais cette chaleur lourde favorise la diffusion du microbe qui va ravager la Provence.
Après une halte à Banon, Angelo atteint la crête qui va de Lure au Ventoux, il descend dans la vallée du Jabron (ici, la géographie est parfaitement respectée) et arrive au hameau des Omergues, où le choléra n’a laissé aucun survivant. Je vous épargnerai les descriptions des cadavres souillés par les vomissures et la diarrhée, ou dévorés par les animaux. Ces descriptions, que l’on retrouve tout le long du roman, ont été reprochées à Giono ; il faut probablement y voir un rappel de l’omniprésence du mal, qui prend ici une dimension métaphysique.
En quittant ce hameau dévasté, Angelo voit arriver un jeune médecin venu secourir les malades. C’est la première des rencontres qu’il va faire au cours du roman : des hommes et des femmes tantôt courageux, tantôt lâches, tantôt généreux, tantôt d’un égoïsme féroce. Il n’est pas question de détailler ici les circonstances de toutes ces rencontres. Rappelons simplement qu’Angelo, au cours de sa traversée de la Provence, fait un séjour sur les toits de Manosque pour éviter d’être lynché par la foule : « C’était le matin étouffant ; de craie ; d’huile blanche bouillante. La peau de tuiles de la ville commençait déjà d’exhaler un air sirupeux. (…) Le grincement incessant de milliers d’hirondelles fouettait l’immobilité torride d’une grêle de poivre. D’épaisses colonnes de mouches fumaient comme de la poussière de charbon de la crevasse des rues. Leur bourdon continu établissait une sorte de désert sonore. » On voit comment Giono retourne des éléments naturels qui pourraient être poétiques et beaux et les utilise pour dessiner le paysage morbide qui sert de cadre au choléra.
La nuit venue, descendant de son toit pour trouver à manger et à boire, Angelo rencontre Pauline de Théus. Vous connaissez certainement les circonstances de cette rencontre dans un escalier, mais je ne peux résister au plaisir de lire ce texte une nouvelle fois : « Angelo était sur la vingt et unième marche, quand, en face de lui, une brusque raie d’or encadra une porte qui s’ouvrit. C’était une très jeune femme. Elle tenait un chandelier à trois branches à la hauteur d’un petit visage en fer de lance encadré de lourds cheveux bruns. » Suit une scène d’une politesse exquise entre les deux personnages, et suivent surtout beaucoup d’aventures vécues en commun, de risques courus, de dangers évités. Le drame se produit au dernier chapitre du livre : Pauline à son tour est terrassée par le choléra. Angelo emploie la seule médecine qu’il connaisse : il passe une nuit entière à frictionner la jeune femme pour maintenir la chaleur dans ses membres et dans son corps. Au petit matin, Pauline est sauvée ; cette friction aura été le seul contact physique entre les deux jeunes gens.
Trois jours après, ils arrivent au château de Théus, près de Gap : « Tous les soirs, Pauline mit une robe longue. Son petit visage, que la maladie avait rendu plus aigu encore, était lisse et pointu comme un fer de lance, et, sous la poudre et les fards, légèrement bleuté. » Angelo achète un nouveau cheval, passe trois jours au château et s’en va vers les montagnes : «l’Italie est là derrière, se disait-il. Il était au comble du bonheur. »
Ce sont les dernières phrases du roman. Il faut expliquer le mot bonheur, qui revient sans cesse sous la plume de Giono et qui va donner son titre au roman suivant, Le Bonheur fou. Comme chez Stendhal, la notion de bonheur est exempte d’égoïsme : seul le bonheur est signe que l’on réussit à vivre selon soi-même et non selon l’opinion et les mots d’ordre (je cite ici Robert Ricatte, l’éditeur de Giono dans la Pléiade).
Quelques mots maintenant du Bonheur fou, troisième roman où apparaît Angelo ; celui-ci a quitté le château de Théus pour participer à la guerre entre le Piémont et l’Autriche en 1848-1849 et dont l’enjeu est la libération et l’unité de l’Italie ; guerre et révolution à la fois, puisqu’il s’agit aussi de remplacer l’absolutisme par la démocratie. Cette guerre a été une défaite pour le Piémont, l’Autriche victorieuse a renforcé son autorité sur la Lombardie et la Vénétie, et Angelo a vu la disparition de ses idéaux révolutionnaires ; pire que la défaite militaire, il a connu la trahison de ses amis carbonari, et même celle de son frère de lait, Giuseppe, qu’Angelo tue en duel : la trilogie se termine comme elle a commencé, par un duel. Angelo, toujours généreux, a chaque fois laissé sa chance au traître.
Un mot sur le premier chapitre de ce roman : c’est l’histoire picaresque d’un carbonaro piémontais qui s’enfuit d’Italie en 1821 après l’échec d’une révolte, qui s’installe à Londres et qui y fait une belle fortune en organisant de loin une armée de libération de l’Italie, et surtout en recueillant les cotisations des carbonari émigrés. Nous reviendrons sur ce texte.
Il faudrait aussi explorer les romans suivants, qu’il a qualifiés de chroniques. Mais le temps va nous manquer et je voudrais souligner en quoi le second Giono diffère du premier :
La nuit venue, descendant de son toit pour trouver à manger et à boire, Angelo rencontre Pauline de Théus. Vous connaissez certainement les circonstances de cette rencontre dans un escalier, mais je ne peux résister au plaisir de lire ce texte une nouvelle fois : « Angelo était sur la vingt et unième marche, quand, en face de lui, une brusque raie d’or encadra une porte qui s’ouvrit. C’était une très jeune femme. Elle tenait un chandelier à trois branches à la hauteur d’un petit visage en fer de lance encadré de lourds cheveux bruns. » Suit une scène d’une politesse exquise entre les deux personnages, et suivent surtout beaucoup d’aventures vécues en commun, de risques courus, de dangers évités. Le drame se produit au dernier chapitre du livre : Pauline à son tour est terrassée par le choléra. Angelo emploie la seule médecine qu’il connaisse : il passe une nuit entière à frictionner la jeune femme pour maintenir la chaleur dans ses membres et dans son corps. Au petit matin, Pauline est sauvée ; cette friction aura été le seul contact physique entre les deux jeunes gens.
Trois jours après, ils arrivent au château de Théus, près de Gap : « Tous les soirs, Pauline mit une robe longue. Son petit visage, que la maladie avait rendu plus aigu encore, était lisse et pointu comme un fer de lance, et, sous la poudre et les fards, légèrement bleuté. » Angelo achète un nouveau cheval, passe trois jours au château et s’en va vers les montagnes : «l’Italie est là derrière, se disait-
Ce sont les dernières phrases du roman. Il faut expliquer le mot bonheur, qui revient sans cesse sous la plume de Giono et qui va donner son titre au roman suivant, Le Bonheur fou. Comme chez Stendhal, la notion de bonheur est exempte d’égoïsme : seul le bonheur est signe que l’on réussit à vivre selon soi-
Quelques mots maintenant du Bonheur fou, troisième roman où apparaît Angelo ; celui-
Un mot sur le premier chapitre de ce roman : c’est l’histoire picaresque d’un carbonaro piémontais qui s’enfuit d’Italie en 1821 après l’échec d’une révolte, qui s’installe à Londres et qui y fait une belle fortune en organisant de loin une armée de libération de l’Italie, et surtout en recueillant les cotisations des carbonari émigrés. Nous reviendrons sur ce texte.
Il faudrait aussi explorer les romans suivants, qu’il a qualifiés de chroniques. Mais le temps va nous manquer et je voudrais souligner en quoi le second Giono diffère du premier :
- Les personnages principaux ne sont plus des paysans : ce sont des bourgeois, surtout dans les chroniques, des militaires, un petit truand, même, dans l’Iris de Suze, sa dernière œuvre.
- Le mal fait son apparition : la cruauté dans Un Roi sans Divertissement, le choléra dans Le Hussard sur le Toit, la trahison dans Le Bonheur fou. L’action naît de la confrontation du héros avec ce mal.
- Surtout le style est devenu plus sec, sans lyrisme, très stendhalien. Il reste cependant très sensuel, comme dans la première manière ; les odeurs en particulier occupent une place très importante : nous avons vu Angelo tomber amoureux d’une femme simplement en respirant son parfum.
- Et l’humour est très présent tout au long de ces romans ; c’est le signe d’une distance que place Giono entre ses personnages et lui, distance qui n’existait pas dans la première manière, où l’auteur était tout entier dans ses personnages.
Une explication
Ces différences ne sont pas minces et témoignent d’une évolution importante du romancier. A quoi sont-
A partir de 1930, la célébrité à laquelle il accède donne à ses idées une caisse de résonnance et son engagement augmente avec la montée des périls. En 1934, il adhère à l’Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires, proche du Parti Communiste. Au cours des mois qui suivent, il multiplie les prises de position à la fois pacifistes et antifascistes, au point que beaucoup pensent qu’il a adhéré au parti communiste.
Mais il n’a jamais pris sa carte, et petit à petit l’écart se creuse entre le parti et lui. Alors que le parti communiste et beaucoup d’intellectuels se mobilisent contre le fascisme, Giono reste un pacifiste convaincu. Même contre l’Allemagne hitlérienne, il refuse de prendre les armes : « quand on n’a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier. »
Or, malgré ses prises de position, début septembre 1939, lorsque la mobilisation est décrétée, Giono obéit. Il se rend à Digne, son lieu de mobilisation. Et le 14 septembre, il fait l’objet de poursuites pour distribution de tracts défaitistes et d’écrits non visés par la censure ; il est incarcéré à Marseille, au fort Saint Nicolas. Mais le dossier est vide : Giono n’a jamais appelé à l’insoumission. Le 11 novembre il sera libéré à la fois de sa prison et de ses obligations militaires. Il a tout de même été emprisonné près de deux mois, en compagnie de détenus de droit commun.
Au cours des années d’occupation qui suivent, Giono continue à écrire, mais publie peu : aucune de ses œuvres maîtresses n’est produite pendant ces années. Fidèle à ses opinions pacifistes, il ne participe pas à la résistance, mais il lui arrive d’aider des résistants ; il cache également, au péril de sa vie, deux Allemands en fuite, dont un juif. Et, bien évidemment, pas un mot de sa part pour justifier la collaboration.
Pourtant, dès la Libération, Jean Giono est de nouveau emprisonné : arrêté à Manosque le 8 septembre 1944, il est transféré dans la citadelle de Saint Vincent des Forts, qui domine la vallée de l’Ubaye. Que s’est-
Mais de même qu’en 1940, rien ne peut lui être reproché. Après cinq mois de prison dans les conditions difficiles de l’hiver, il est finalement libéré le 31 janvier 1945 et assigné à résidence hors de Manosque. Il figure cependant sur la « liste noire » du Comité National des écrivains : il n’a pas le droit de publier et n’a effectivement rien publié pendant les trois années 1944, 1945 et 1946.
Dès lors, comment s’étonner de son aigreur ? Jean Giono a perdu durant cette période son optimisme naturel et ses illusions pacifistes ; jamais plus il ne fera de déclaration politique. L’histoire du révolutionnaire enrichi qui ouvre le Bonheur fou, et dont je vous parlais tout à l’heure, traduit avec cynisme les désillusions du romancier. Son œuvre va s’engager dans une voie toute différente de la précédente, et cette voie va lui assurer une nouvelle reconnaissance de ses lecteurs et une nouvelle renommée. Car ce second Giono est aussi admirable que le premier.
Cette division en deux périodes de l’œuvre a été contestée, et, de fait, on peut citer dans la première manière des passages qui annoncent la seconde et inversement… mais vous conviendrez qu’il me faudrait une autre communication pour trouver ce qui fait l’unité de l’œuvre de Jean Giono.
Vous avez compris que cette communication avait pour principal objectif celui de vous engager à lire ou à relire Jean Giono. J’espère vous avoir convaincu et c’est dans cet espoir que je vous remercie de m’avoir écouté.
